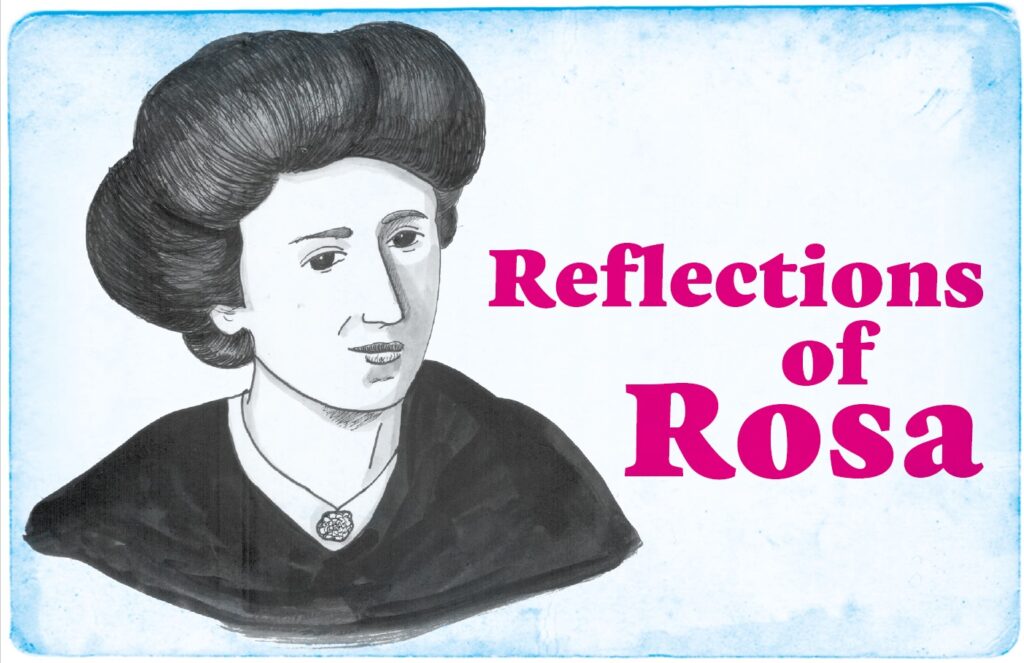Intervention de Walter Baier le 12 Mars 2019 à l’occasion du centenaire de la mort de Rosa Luxemburg organisé par transform.at! et l’Association centrale autrichienne des retraités (Zentralverband der Pensionistinnen und Pensionisten Österreichs – ZVPÖ).
Oui, Rosa Luxemburg compte parmi les grands. Elle est un modèle, dont la mémoire a largement été bâtie autour de son assassinat, lequel a fait d’elle une martyre du mouvement socialiste.
À cet égard, Rosa Luxemburg partage le sort d’Antonio Gramsci et Ernesto Che Guevara, dont la vie et le travail se sont de même achevés prématurément et dans la violence, – ouvrant ainsi la voie à de multiples interprétations.
L’exemple le plus célèbre dans le cas de Luxemburg concerne son ouvrage posthume La Révolution russe. Celui-ci débute ainsi : « La Révolution russe est le fait le plus considérable de la Guerre mondiale. »
Ce qui suit est néanmoins un commentaire critique brillant des politiques menées par les bolcheviks, qui culmine dans ces lignes fameuses :
« La liberté réservée aux seuls partisans du gouvernement, aux seuls membres d’un parti – fussent-ils aussi nombreux qu’on voudra – ce n’est pas la liberté. La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement. »
L’argument qu’elle ajoute ici n’est pas moins important : « Non pas par fanatisme pour la ’justice’, mais parce que tout ce qu’il y a d’instructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté politique tient dans cela, et que celle-ci perd de son efficacité quand la ’liberté’ devient un privilège. » Dit autrement, cet argument constitue l’antithèse dialectique du démarrage. Cependant, l’antithèse elle-même se trouve à son tour remplacée par une antithèse supplémentaire avant d’être généralisée dans une synthèse. Notamment, Rosa Luxemburg revient dans les dernières phrases de l’ouvrage sur son introduction, reconnaissant une nouvelle fois les réalisations historiques des bolcheviks, mais en enrichissant cette fois ce constat de ses observations critiques :
« En ce sens, il leur reste le mérite impérissable dans l’histoire d’avoir pris la tête du prolétariat international en conquérant le pouvoir politique et en posant dans la pratique le problème de la réalisation du socialisme[…]. En Russie, le problème ne pouvait être que posé : il ne pouvait pas être résolu en Russie. Et c’est en ce sens que l’avenir appartient partout au “bolchevisme”. »
La révolution d’Octobre ne nous est donc pas présentée ici comme un événement historique d’ordre messianique, mais, au démarrage, comme un simple fait, en l’occurrence le fait le plus important de la Première Guerre mondiale. Les bolcheviks sont ensuite critiqués, non pas du point de vue de libéraux que la Révolution aurait choqués, mais dans la perspective de la Révolution elle-même, ce qui a l’avantage de permettre la définition de la place de la Révolution dans l’Histoire : à savoir qu’elle a posé le problème du socialisme sans pour autant le résoudre. « En ce sens », c’est-à-dire dans le sens où a été posé un problème qui ne pouvait pas être résolu en Russie, l’avenir appartient au socialisme, écrivait-elle. Et seulement en ce sens !
Qu’on est loin des panégyriques infantiles de la « Grande Révolution Socialiste d’Octobre » qui étaient d’usage sous Staline et encore très pratiqués jusque dans les années 1980 dans les partis communistes – et aujourd’hui encore par endroits ! Par sa position, Rosa Luxembourg s’est tenue à la seule place digne d’une vraie révolutionnaire, c’est-à-dire au milieu des chaises, en refusant de se poser.
Elle avait réussi à irriter tout autant les libéraux et sociaux-démocrates par son engagement sans équivoque en faveur de la Révolution, qu’elle avait irrité les dinosaures communistes du parti des années 1920 par sa critique de la politique bolchevique. C’est ainsi qu’en 1928, au Parti communiste allemand comme dans l’Internationale communiste, le concept de « luxemburgisme » devint une invective entraînant réprobation et mise à l’écart pour celles et ceux à qui elle était adressée. Le phénomène atteignit son point culminant avec la dissolution du Parti communiste de Pologne en 1937 et la liquidation physique de ses cadres en Union soviétique.
Mais revenons à Rosa Luxemburg elle-même.
Quand elle s’installa en Allemagne en 1898, elle était déjà une marxiste célèbre. Elle s’était notamment fait connaître dans la social-démocratie allemande par sa polémique avec Eduard Bernstein : la fameuse « querelle du révisionnisme ». « Ce qu’on appelle communément l’objectif final du socialisme n’est rien pour moi ; le mouvement est tout », disait Bernstein. L’objectif est tout tandis que le mouvement n’est rien s’il n’est pas subordonné au précédent, répondait Luxemburg. Dans la perspective communiste, bon et mauvais semblent se distinguer sans équivoque. Mais rien n’est jamais sans ambiguïté en histoire et en politique. Bernstein, par exemple, fut de ceux qui, en 1914 aux côtés de Luxemburg, s’opposa au soutien apporté à la guerre par le groupe parlementaire SPD.
Plus important encore, Bernstein exprima ce qui préoccupait le SPD depuis longtemps et qui ne pouvait pas être résolu avec les outils intellectuels fournis par le Manifeste du parti communiste.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les progrès de l’industrie et la lutte des classes permirent à la classe ouvrière d’enregistrer peu à peu des progrès, tant sur le plan social que culturel. De nombreux travailleurs continuaient à végéter dans la misère, mais d’autres avaient désormais, en rupture avec ce que Marx décrivait un demi-siècle auparavant, plus à perdre « que leurs chaînes ». Et, en contradiction avec la vision du Manifeste du parti communiste, la perspective d’une révolution socialiste semblait bien peu se profiler à l’horizon. Après la défaite de la Commune de Paris en 1871, il était partout devenu impossible pour les socialistes de croire au succès d’un soulèvement armé parmi l’un des pays développés.
En parallèle, avec la fin des lois anti-socialistes en 1890, le SPD se trouva en mesure de construire un électorat qui se comptait en millions. Une expansion continue jusqu’à la victoire apparaissait possible. Ceux qui, comme Bernstein, réclamaient une révision des conceptions antérieures, pouvaient donc, d’un côté, faire valoir que le SPD avait depuis longtemps cessé dans la pratique d’être un parti révolutionnaire. Mais ils pouvaient en outre citer Friedrich Engels, lequel avait écrit en 1891 que l’ancienne société pouvait mûrir et se transmuer pacifiquement en une société nouvelle où l’organe représentatif du peuple concentrerait tout le pouvoir et où l’on pourrait constitutionnellement faire ce que l’on voulait aussi longtemps qu’on avait le soutien de la majorité du peuple.
Néanmoins, la révision demandée par Bernstein fit scandale au sein du parti. Bernstein et ses critiques orthodoxes dans la direction du parti, Karl Kautsky en premier lieu, se rejoignaient pourtant tous dans la pratique : personne ne réfléchissait en termes de révolution armée. Mais, tandis que Bernstein préconisait de l’afficher en conformant la théorie à cette pratique réformiste, les orthodoxes préféraient continuer de masquer la pratique réformiste sous l’adhésion toute verbale à l’objectif du socialisme.
C’est ici qu’entre en scène Luxemburg. Contrairement à Bernstein, elle a interprété la montée du capitalisme monopoliste, de l’impérialisme et du colonialisme non pas comme le signe d’un affaiblissement, mais comme celui d’une exacerbation au contraire des antagonismes de classe. Et, à la différence de Kautsky, la phraséologie révolutionnaire lui répugnait. À ses yeux, la conquête de bastions parlementaires ou encore la croissance organique ne constituaient pas des objectifs en soi mais seulement des atouts en tant qu’éléments d’une stratégie politique plus large subordonnée aux objectifs généraux du mouvement. Important pour elle – et toujours aussi important aujourd’hui ! – était la conviction que, sans implication dans les questions de la vie quotidienne, la politique socialiste se réduisait au culte de formules obsolètes. Les partis socialistes, cependant, ne sont pas des organisations électoralistes. La politique de la vie quotidienne, la représentation des intérêts ni le réformisme ne sont des objectifs en eux-mêmes. Ils ne peuvent remplacer la participation du parti socialiste aux confrontations politiques générales majeures. L’absence politique ne peut être compensée par des paroles révolutionnaires éculées à prononcer dans les moments solennels, – alors même qu’on se tient soigneusement à distance des débats politiques pour ne pas effrayer les électeurs potentiels.
Par-dessus tout, la pensée de Rosa Luxemburg était internationaliste. C’est en partie explicable par ses origines polonaises, la Pologne étant alors divisée entre les trois grandes puissances réactionnaires de l’Autriche, de l’Allemagne et de la Russie depuis le Congrès de Vienne de 1814. Lorsque la social-démocratie polonaise fut créée en 1870, celle-ci tendait à se percevoir comme un mouvement national, inscrivant sur ses bannières le thème de la lutte pour l’unité et l’indépendance nationale de la Pologne. Luxembourg a dit « non » : un parti ouvrier ne peut jamais se définir d’abord comme un mouvement national. Elle donna ce conseil au nouveau mouvement social-démocrate : « Vous êtes appelés à réaliser non pas le droit des nations à l’autodétermination, mais seulement le droit à l’autodétermination de la classe ouvrière, de la classe exploitée et opprimée – le prolétariat. »
Parfois, cette primauté de principe accordée aux intérêts de classe par rapport aux intérêts nationaux a été décriée comme « cosmopolitisme bourgeois ». Cependant, l’argument de Luxemburg n’a rien de bourgeois. Ce qu’elle a dit en substance est : l’essor du capitalisme force les frontières de l’État-nation. Les socialistes ne peuvent donc pas se fixer pour tâche de s’allier avec les forces les plus rétrogrades de la société dans leur bataille contre la progression capitaliste. Au lieu de cela, elle en appelle à ses camarades, leur demandant de forger l’alliance la plus étroite possible avec les travailleurs des autres nations et, pour ce qui concerne leur pays d’origine, « de combattre avant tout pour une liberté de constitution au sein de l’Empire russe et pour des libertés propres à la Pologne ».
L’État national polonais émergea finalement en 1918 sur les décombres de la guerre mondiale. La position de Luxembourg semblait réfutée. Mais elle a été réfutée comme furent réfutées les attentes de tous les révolutionnaires qui imaginaient une révolution socialiste européenne en 1918. C’est ainsi que les bolcheviks restèrent seuls : le problème qu’ils avaient posé ne put être résolu. En Europe centrale, les empereurs tombaient et les révolutions nationales qui donnaient naissance aux nouveaux États restaient cantonnées dans des limites bourgeoises. Luxemburg prit acte avec amertume de la vague nationaliste déclenchée par l’effondrement des États multinationaux dans le sillage de la Première Guerre mondiale.
Pourtant, l’erreur de Lénine, qui affirmait sans réserve le droit de chaque nation à former son propre État, me semble aujourd’hui plus fatidique que celle de Luxemburg. Le système d’États créés en Europe centrale après la Première Guerre mondiale par les traités de paix de Versailles, de Saint-Germain et du Trianon, système qui repose sur le principe national, a montré sa caducité, conduisant à l’étape suivante de la « guerre civile mondiale ». Vingt ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale surpassait largement la Première Guerre mondiale à la fois par le nombre de victimes et en termes de barbarie.
C’est la raison pour laquelle, au terme de la plus terrible de toutes les guerres européennes, le droit illimité des États à leur souveraineté s’est vu apposer des restrictions sous la forme de l’intégration militaire et économique tant à l’Est qu’à l’Ouest. Et les dommages seraient incalculables pour les peuples si, trois quarts de siècle plus tard, suite à la disparition de l’ordre créé à Yalta par les alliés victorieux de la Seconde Guerre mondiale, il devait y avoir une autre « nuit de Walpurgis nationaliste sur le mont Brocken », pour reprendre l’expression de Luxemburg.
L’accusation a été portée que ses vues sur l’avenir étaient trop en avance sur son temps. On peut le dire certainement de son hypothèse de l’effondrement prochain du capitalisme du fait de ses contradictions économiques. On peut le dire aussi pour la « disparition complète des langues des petites nations » devant conduire au « regroupement final de l’ensemble de l’humanité cultivée dans une seule langue et nationalité ».
On pourrait appeler cela de l’utopisme, mais seulement au sens où tous les grands explorateurs, Christophe Colomb inclus, étaient des utopistes, capables de donner la direction générale du voyage, mais en se trompant sur quelques détails importants et surtout en faisant des erreurs de calcul concernant la distance à parcourir. Ce fut précisément en ce sens que Rosa Luxemburg nous a montré la direction : non le retour à un nationalisme historiquement dépassé, mais la progression vers une humanité cosmopolite et rassemblée, si ardu et pénible que soit le chemin. Car il n’existe aucune autre façon d’apporter une réponse au dilemme « socialisme ou barbarie ».
——————
Voir aussi, dans la même série :